La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) : un pilier essentiel de la sécurité des soins en établissement de santé
La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) représente une composante indispensable de la chaîne de soins au sein des établissements de santé, de certains établissements médico-sociaux et même des services d'incendie et de secours. Plus de 2 500 PUI sont actuellement autorisées en France, témoignant de leur rôle central. Elles sont les garantes de la qualité et de la sécurité du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles, assurant des missions variées allant de la gestion des produits de santé à la dispensation, en passant par la préparation et le contrôle. Au-delà de ces fonctions logistiques et techniques, les PUI sont également des acteurs majeurs de la pharmacovigilance et de la matériovigilance, et promeuvent activement le bon usage des produits de santé.
L'évolution rapide des pratiques médicales et des exigences en matière de coopération entre établissements a conduit à une refonte profonde du cadre réglementaire régissant les PUI. Initiée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, cette refonte s'est concrétisée par l'ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 et le décret n°2019-489 du 21 mai 2019. Ces textes ont élargi et précisé les missions des PUI, notamment en introduisant de nouvelles dispositions concernant la pharmacie clinique et en facilitant les coopérations inter-établissements pour une prise en charge pharmaceutique optimisée.
Le cadre réglementaire et les missions fondamentales des PUI
Le fonctionnement et l'organisation des PUI sont encadrés par une législation stricte, dont les bases ont été modernisées pour s'adapter aux défis actuels du système de santé. Le décret n°2019-489 du 21 mai 2019 est le texte d'application clé qui redéfinit les conditions d'implantation et de fonctionnement des PUI, les règles d'exercice pour les pharmaciens, et surtout, les missions et activités qu'elles sont habilitées à accomplir.
Les missions fondamentales des PUI sont plurielles et couvrent l'intégralité du circuit du produit de santé au sein des structures où elles sont implantées. Elles comprennent notamment:
- La gestion des produits de santé (médicaments, produits, objets du monopole pharmaceutique, dispositifs médicaux stériles).
- L'approvisionnement de ces produits.
- La vérification des dispositifs de sécurité.
- La préparation (magistrale, hospitalière) et la reconstitution de médicaments.
- Le contrôle qualité des produits.
- La détention et l'évaluation des produits de santé.
- La dispensation des médicaments et DM stériles.
En complément de ces missions traditionnelles, le cadre réglementaire modernisé a mis l'accent sur le développement de la pharmacie clinique. Il s'agit d'actions visant à améliorer la sécurité, la pertinence et l'efficience de l'utilisation des produits de santé, en étroite collaboration avec l'équipe de soins et le patient lui-même. Les PUI sont également tenues de contribuer activement à la pharmacovigilance (surveillance des effets indésirables des médicaments) et à la matériovigilance (surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux).
Le Référentiel de Pharmacie Hospitalière, élaboré par la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) en partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS), fournit un cadre détaillé pour l l'amélioration des pratiques professionnelles et leur efficience, en se centrant sur la prise en charge thérapeutique du patient. Ce document structuré en sept chapitres aborde en profondeur la politique et le management des PUI, leur gestion opérationnelle, la qualité et la gestion des risques, l'achat et la logistique, la pharmacie clinique, la préparation et le contrôle, ainsi que l'enseignement et la recherche. Il insiste sur l'importance d'intégrer le bon usage des produits de santé et une approche médico-économique dans les orientations stratégiques de la PUI.
Les établissements autorisés et les activités spécifiques des PUI
Le décret relatif aux PUI a précisé la liste des établissements, structures ou organismes autorisés à disposer d’une PUI. Cette liste est exhaustive et reflète la diversité des contextes de soins et de services nécessitant un support pharmaceutique interne. Parmi eux figurent:
- Les établissements de santé traditionnels.
- Les hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides.
- Les groupements de coopération sanitaire (GCS), permettant la mutualisation des moyens.
- Les installations de chirurgie esthétique.
- Une variété d'établissements et services médico-sociaux, notamment ceux assurant l'hébergement de personnes âgées et handicapées, ainsi que les structures spécifiques comme les "lits halte soins santé" et "lits d'accueil médicalisés".
- Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
- Les services d’incendie et de secours, incluant le Bataillon de marins-pompiers de Marseille et la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
- La Pharmacie centrale des armées.
Certaines activités exercées par les PUI sont jugées comme comportant des risques particuliers et nécessitent à ce titre une autorisation spécifique délivrée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour une durée de sept ans (initialement cinq ans, modifiée par l'ordonnance n° 2020-1407). Ces activités incluent:
- Les préparations magistrales stériles.
- Les préparations magistrales contenant des substances dangereuses pour le personnel et l’environnement.
- Les préparations hospitalières.
- La reconstitution de spécialités pharmaceutiques.
- La mise sous forme appropriée des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement.
- La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
- La préparation des médicaments expérimentaux.
- La préparation des dispositifs médicaux (DM) stériles, qui englobe la stérilisation.
En outre, une PUI est également tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément les activités de préparation de doses à administrer de médicaments, l'importation de médicaments expérimentaux, et l'importation de préparations réalisées conformément à des normes de bonnes pratiques et en provenance de l’Union Européenne.
Les PUI qui exercent ces activités à risques particuliers devaient obtenir une nouvelle autorisation au plus tard le 31 décembre 2022 (date repoussée d'un an par rapport à la date initiale). Pour celles qui n'exercent pas d'activités à risque mais étaient déjà autorisées sous l'ancienne réglementation, une nouvelle autorisation est requise avant le 31 décembre 2024. Le décret introduit également des spécificités, par exemple, les PUI des établissements médico-sociaux peuvent être autorisées uniquement pour la préparation de doses à administrer et les préparations magistrales, tandis que les installations de chirurgie esthétique peuvent aussi réaliser la préparation de DM stériles.
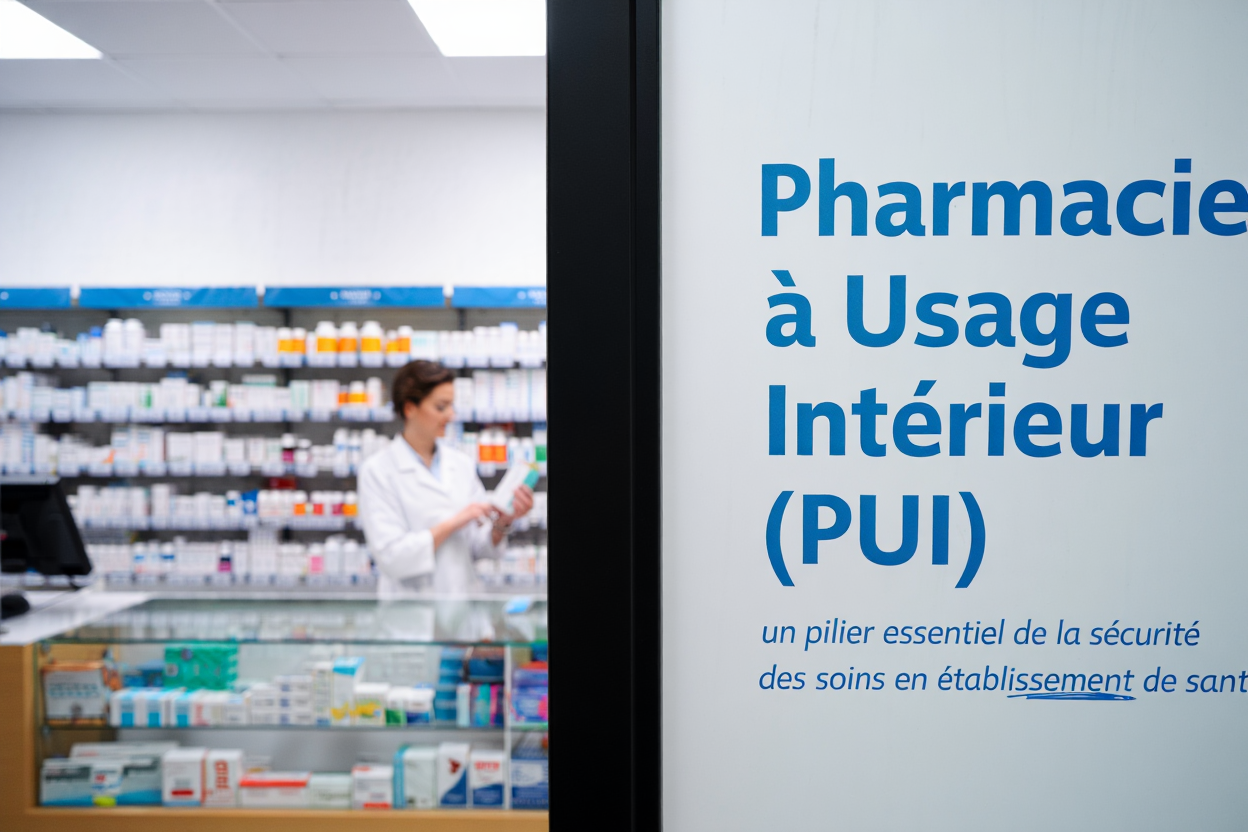
Le rôle clé du pharmacien gérant et de l'équipe en PUI
Le pharmacien chargé de la gérance de la PUI est la pierre angulaire de son fonctionnement, dont les fonctions sont détaillées dans la réglementation. Il est, de manière générale, responsable de l'ensemble des missions et activités de la PUI. Cette responsabilité implique une autorité hiérarchique sur le personnel affecté à la PUI, ainsi que la direction et la surveillance du travail des internes et étudiants en pharmacie.
Le temps de présence du pharmacien gérant est également réglementé: il ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Dans les établissements médico-sociaux, ce temps de présence peut être ajusté en fonction des besoins des personnes accueillies, jusqu'à un minimum de deux demi-journées par semaine. En cas d'absence, le pharmacien gérant doit impérativement être remplacé. Un même pharmacien peut exceptionnellement assurer la gérance de plusieurs PUI, jusqu'à deux (ou trois si elles relèvent d'établissements médico-sociaux), à condition de pouvoir respecter son temps de présence et d'accomplir quotidiennement ses missions dans chacune d'elles. Le statut du pharmacien gérant varie selon le type d'établissement : il peut exercer les fonctions de chef de pôle ou de responsable d'une structure interne de pharmacie dans les établissements publics, ou être un pharmacien salarié lié par un contrat de gérance dans les établissements privés.
L'équipe de la PUI est également soumise à des exigences strictes en matière de qualifications et de formation. Les conditions de remplacement d'un pharmacien exerçant en PUI ou d'un pharmacien gérant par des internes en pharmacie sont précisées: l'interne doit avoir validé cinq semestres dans chacun des quatre domaines obligatoires de sa maquette de formation. Un certificat valable un an, délivré par le président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens, doit être remis au directeur d'établissement et au pharmacien gérant. Le remplacement d'un pharmacien gérant par un interne est limité à une durée maximale de quatre mois par an, et à un mois par remplacement, nécessitant la signature d'une convention avec l'établissement.
Le Référentiel de Pharmacie Hospitalière met en lumière la nécessité de s'assurer du recrutement du personnel nécessaire, avec des qualifications et compétences adaptées aux activités de la PUI, y compris pour la permanence pharmaceutique. La formation initiale et continue du personnel est essentielle, intégrant les formations obligatoires et leur renouvellement. L'évaluation régulière des acquis et des compétences est également prévue. La PUI doit s'impliquer activement dans la gestion des risques professionnels pour l'ensemble de son personnel, identifiant les postes à risque, organisant la surveillance médicale et analysant les incidents pour proposer des actions préventives et correctives.
La pharmacie clinique : au cœur de la prise en charge thérapeutique du patient
La pharmacie clinique est une discipline en pleine expansion, essentielle à la modernisation de la prise en charge des patients. Elle est définie comme toute action du pharmacien contribuant à la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé, en collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe de soins et en y associant le patient. L'objectif principal est d'optimiser les choix thérapeutiques, la dispensation et l'administration des médicaments, de formuler des avis pharmaceutiques pour l'équipe médicale, et de favoriser la compréhension et l’observance du traitement par le patient. Cette approche proactive vise à réduire les accidents iatrogènes, à renforcer la sécurité des prescriptions et à maîtriser les coûts des soins.
Le décret n°2019-489 du 21 mai 2019 définit explicitement les actions de pharmacie clinique que les PUI sont désormais tenues de mener:
- L'expertise pharmaceutique clinique des prescriptions: elle implique une analyse approfondie des ordonnances (médicaments, produits, dispositifs médicaux stériles) pour garantir le suivi thérapeutique des patients. Cela comprend la vérification de la posologie, des interactions médicamenteuses, des rythmes d'administration, des incompatibilités physico-chimiques, et l'adéquation avec la présentation commerciale.
- La réalisation de bilans de médication: une évaluation complète des traitements du patient pour identifier les problèmes liés aux médicaments.
- L'élaboration de plans pharmaceutiques personnalisés: ces plans sont conçus en collaboration avec l'équipe de soins, le patient et, si nécessaire, son entourage, pour adapter au mieux la stratégie thérapeutique.
- Les entretiens pharmaceutiques et autres actions d'éducation thérapeutique: le pharmacien informe et conseille le patient sur le bon usage de ses médicaments, ses objectifs thérapeutiques, les surveillances biologiques à effectuer, et la bonne manipulation des dispositifs d'administration.
- L'élaboration de la stratégie thérapeutique: visant à assurer la pertinence et l'efficience des prescriptions, ainsi qu'à améliorer l'administration des médicaments.
Le rôle du pharmacien clinicien est également détaillé dans le Référentiel de Pharmacie Hospitalière. Il doit maîtriser les stratégies thérapeutiques nationales et internationales, et mettre en place des protocoles locaux pour optimiser l'utilisation des produits de santé. L'accès au dossier du patient et la connaissance de ses données cliniques, biologiques et thérapeutiques sont primordiaux pour l'analyse de prescription et l'optimisation des traitements. Le pharmacien clinicien doit s'intégrer activement aux équipes médicales et paramédicales, participant aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), aux staffs médicaux et aux visites de services pour proposer l'optimisation des thérapeutiques médicamenteuses et des dispositifs médicaux stériles.
Enfin, l'implication pharmaceutique dans l'éducation thérapeutique du patient (ETP) est reconnue comme une composante essentielle de la prise en charge globale. Le pharmacien, formé spécifiquement à l'ETP, contribue au diagnostic éducatif, aide le patient à acquérir des compétences d'auto-soins et à gérer ses traitements et leurs effets indésirables.
Gestion de la qualité et des risques : une priorité pour les PUI
La gestion de la qualité et des risques (GdR) est au cœur des préoccupations des PUI, s'inscrivant dans une démarche institutionnelle plus large d'amélioration continue de la sécurité des soins. Les PUI sont tenues de définir une politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité de leurs prestations pharmaceutiques, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement de santé. Cette politique vise à promouvoir une culture qualité au sein du personnel de la PUI par des actions de sensibilisation et de formation et la mise en place de démarches d’amélioration des pratiques pharmaceutiques (APP). Une gestion documentaire qualité rigoureuse, en cohérence avec celle de l'établissement, est également essentielle pour formaliser les processus et assurer la traçabilité des informations.
La gestion des risques au sein des PUI est un processus continu et systématique, comprenant plusieurs volets:
- Gestion des risques a priori: Il s'agit d'identifier et de hiérarchiser les risques potentiels liés aux activités de la PUI (par exemple, préparations de cytotoxiques, gestion des stupéfiants, stérilisation) avant qu'ils ne se manifestent. Des actions de prévention sont définies, le personnel est formé à l'analyse des risques (par des méthodes comme l'AMDEC ou l'APR), et des documents précisant les actions correctives immédiates sont mis en place.
- Gestion des événements indésirables: Une organisation est en place pour la déclaration, l'enregistrement et l'analyse des événements indésirables survenus. Cette démarche, cohérente avec l'organisation institutionnelle, implique une analyse des causes, un retour d'information aux acteurs concernés et la mise en œuvre de plans d'action correctives pour éviter leur récidive. L'informatisation de la déclaration est recherchée pour faciliter le processus.
- Gestion des erreurs liées à l'utilisation des produits de santé: L'équipe pharmaceutique est intégrée à une organisation spécifique d'analyse de ces erreurs, souvent pluridisciplinaire. Des actions de formation et de sensibilisation sont menées, et le recueil et l'analyse des erreurs sont assurés selon des méthodologies validées, telles que la REMED (Revue des Erreurs liées aux Médicaments). Le patient est également informé sur la prévention des erreurs.
- Intégration à l'organisation des vigilances sanitaires: Les PUI participent activement aux systèmes de pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance, etc.. Elles sont organisées pour répondre aux alertes sanitaires (descendantes, des autorités compétentes ou fabricants) et pour signaler les événements indésirables (ascendantes), avec des procédures spécifiques pour le rappel de produits, la mise en quarantaine et la destruction.
- Gestion des crises: L'équipe pharmaceutique est intégrée aux plans d'urgence de l'établissement (par exemple, plan blanc, risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques – NRBC, épidémie de grippe). Le personnel est formé et entraîné à la gestion de ces situations, y compris celles à fort impact médiatique, afin d'assurer la continuité de la production et de la dispensation.
Parallèlement à la GdR, l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est une obligation pour les pharmaciens et préparateurs en pharmacie hospitalière, intégrée au dispositif de développement professionnel continu (DPC). Les PUI promeuvent les EPP pour améliorer la pertinence des soins et les indicateurs de pratique pharmaceutique, en s'appuyant sur les travaux des sociétés savantes et les bonnes pratiques.
De l'achat à la dispensation : la logistique des produits de santé en PUI
La PUI joue un rôle fondamental dans la logistique des produits de santé, englobant l'achat, l'approvisionnement, la gestion des stocks et la délivrance aux unités de soins. Ce processus complexe est régi par des principes d'efficience, de sécurité et de conformité réglementaire.
La politique d'achat des produits de santé est définie en concertation avec les besoins des patients et sous l'égide de la Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (CMDMS). Elle intègre une approche médico-économique et bénéfice/risque pour optimiser les choix. Le Référentiel précise que l'analyse des besoins est réalisée par la CMDMS, et les acteurs de l'achat doivent avoir une formation spécialisée (pharmaceutique, économique, juridique). Les critères de choix des produits sont définis par un groupe d'experts et incluent des aspects techniques (conditionnement unitaire), économiques et associés (prestations fournisseurs, conditions logistiques, économie durable). Des contrats sont établis avec les fournisseurs, et leur suivi est rigoureux.
L'approvisionnement de la PUI en produits de santé nécessite une cartographie et une prévision précises. Cela implique la tenue à jour de référentiels par produit et par fournisseur, la consultation des historiques de consommations et l'évaluation des besoins futurs avec les utilisateurs. Les règles de stockage sont définies en tenant compte des caractéristiques des produits (antidotes, plans sanitaires, chaîne du froid), des volumes et des rythmes d'utilisation. L'organisation et la planification de l'approvisionnement sont cruciales, avec la définition des exigences (lieux/horaires de livraison), des règles d'approvisionnement et de réception adaptées à la spécificité des produits (urgence, stock, hors-stock, dépôt-vente, médicaments dérivés du sang – MDS, dispositifs médicaux implantables – DMI). Des seuils de sécurité des stocks sont établis, et des procédures spécifiques gèrent les incidents de réception.
L'optimisation de la gestion des stocks est un enjeu majeur. Une politique de gestion des stocks est définie au sein de la PUI, avec des objectifs clairs (stock moyen, stock de sécurité, mode de réapprovisionnement). La cartographie des produits prend en compte le nombre d'entrées/sorties, les utilisateurs et le degré d'urgence. La PUI s'assure que les zones d'implantation (réception, stockage de masse, stockage détail, expédition) sont clairement définies et que les règles de gestion par nature et catégorie de produits sont appliquées. Des inventaires réguliers sont réalisés pour évaluer le niveau de stock, analyser les mouvements et retirer les produits périmés, détériorés ou obsolètes. La gestion des chariots d'urgence et la procédure de retour des produits de santé sont également des éléments clés.
Enfin, l'assurance de la délivrance globale des produits de santé aux unités de soins est une mission essentielle. Cela comprend l'organisation des demandes des unités de soins, l'évaluation des besoins, la planification des demandes et la mise en place de procédures d'approvisionnement pour les urgences et les demandes exceptionnelles. La gestion des produits de santé dans les unités de soins est organisée par la PUI, avec la définition et la révision des dotations, des rythmes d'approvisionnement, et des protocoles de gestion des stocks et de rangement. La maîtrise du circuit de la délivrance globale implique l'analyse et la validation des demandes avant délivrance, l'utilisation de bordereaux de livraison et de conteneurs adaptés pour garantir l'intégrité et la traçabilité des produits, ainsi que la mise en place de circuits spécifiques pour les produits sensibles (chaîne du froid, urgences).

Préparation et contrôle des médicaments et dispositifs médicaux stériles
Les PUI sont des centres d'expertise pour la préparation et le contrôle de nombreux produits, garantissant leur conformité et leur sécurité. Ce domaine exige une maîtrise rigoureuse de l'environnement et des processus spécifiques pour chaque type de produit.
La maîtrise de l'environnement est fondamentale, notamment pour la préparation de médicaments et de dispositifs médicaux stériles. Cela inclut:
- La maîtrise de la qualité de l'eau: La conception et l'entretien du réseau de production d'eau traitée (adoucie, osmosée, pour hémodialyse) sont essentiels. Des exigences physicochimiques et microbiologiques sont définies, avec des programmes d'entretien, de surveillance et de gestion des incidents pour assurer la continuité de la production.
- La maîtrise de la qualité de l'air: Pour les zones à atmosphère contrôlée (ZAC), des exigences particulaires (classes de propreté ISO) et microbiologiques sont établies. Les systèmes de traitement d'air (centrales, hottes, isolateurs) sont soumis à des programmes d'entretien et de surveillance réguliers, avec des contrôles de pression, température, hygrométrie et biocontamination.
- La maîtrise des surfaces: Tous les types de surfaces (plans de travail, murs, sols, plafonds) dans les secteurs d'activité de la PUI doivent répondre à des caractéristiques définies. Des modalités et fréquences de nettoyage/désinfection, ainsi que des contrôles microbiologiques, chimiques ou de non-contamination radioactive, sont définis et appliqués.
- L'organisation du circuit des déchets: La gestion des déchets spécifiques (radiopharmacie, chimiothérapie) est organisée en collaboration avec les structures compétentes de l'établissement, avec identification des déchets à risque, définition des circuits d'élimination et programmes de surveillance.
La préparation des médicaments couvre un large éventail, incluant les préparations magistrales et hospitalières, les médicaments expérimentaux, les préparations radiopharmaceutiques, les nutritions parentérales et les cytotoxiques. Ce processus comprend plusieurs étapes clés:
- L'analyse pharmaceutique d'une préparation: Un pré-requis essentiel, déclenché par la validation pharmaceutique de la prescription. Elle nécessite une transmission sécurisée des ordonnances et l'accès au dossier patient, ainsi qu'un thésaurus des préparations et un interfaçage avec les logiciels de prescription.
- L'analyse de faisabilité d'une préparation: Après validation de la prescription, le pharmacien évalue la faisabilité technique et scientifique, en identifiant les matières premières et DM nécessaires, vérifiant les stocks, et utilisant des outils d'aide à l'analyse physico-chimique. Une procédure d'enregistrement des "non faisabilités" est formalisée.
- La réalisation d'une préparation: Elle suit des modes opératoires précis pour chaque type de préparation, incluant les règles d'habillage et de protection, la gestion des matières premières et DM (identification, libération, contrôle), et la prévention des contaminations croisées et erreurs. La traçabilité des produits, des acteurs et des actes est assurée.
- La libération et la délivrance d'une préparation: Les modalités de mise en quarantaine et de libération (paramétrique ou non, avec contrôles libératoires) sont définies. Le pharmacien procède à la libération après contrôle de la fiche de préparation et de la conformité. Les préparations non conformes sont enregistrées. Les informations sur le bon usage et les conditions de conservation sont transmises, et le suivi des péremptions et des retours est assuré.
La préparation des dispositifs médicaux stériles (DMS) est un processus critique qui inclut:
- La maîtrise des éléments d’entrée: Achat des DM, fiches techniques précisant les modalités de traitement, organisation du circuit des nouveaux produits et des DM en prêt.
- L'assurance de la propriété du client et la préservation des DM à stériliser: Formation du personnel, prise en charge conforme aux fiches techniques, stockage adapté et information en cas de perte ou de dommage.
- La disposition des informations relatives aux risques de transmission des agents transmissibles non conventionnels (ATNC): Détection du risque, transmission de l'information et adaptation du processus de stérilisation.
- La réception en stérilisation: Modalités de prise en charge des DM après utilisation (prédésinfection), définition des responsabilités, traçabilité des étapes et planification des flux.
- Le lavage et le séchage: Procédés (privilégiant les laveurs désinfecteurs), choix des détergents, cycles de lavage, accessoires et contrôles.
- La recomposition des plateaux opératoires et des sets de soins: Organisation, vérification des DM, contrôles de fonctionnalité, lubrification, calage et traçabilité, en collaboration avec les équipes chirurgicales.
- Le conditionnement: Organisation et traçabilité, choix des systèmes d'emballage (sachets, feuilles, conteneurs), techniques de scellage, vérification et maintenance des équipements.
- La stérilisation et la libération des DMS: Définition des procédés (vapeur, basse température), organisation, contrôles avant, pendant et après cycle, formation et habilitation du personnel, application des dates de péremption et traçabilité.
- Le stockage adapté pour les DMS: Organisation et gestion du stock et des conditions de stockage (en stérilisation et dans les unités de soins), gestion des produits périmés et équipements adaptés.
Enfin, les contrôles sont une fonction transversale essentielle:
- Contrôles des matières premières à usage pharmaceutique: Organisation des contrôles à réception, définition des méthodes de prélèvement et de contrôle, traçabilité et gestion des non-conformités.
- Contrôles physico-chimiques et microbiologiques des produits finis: Préparations magistrales et hospitalières, avec des plans de contrôle définis et des résultats validés par le pharmacien.
- Contrôles des eaux pour hémodialyse: Procédures de prélèvement et de contrôle conformes à la pharmacopée européenne, planification et validation des résultats.
- Contrôles des fluides médicaux: Le pharmacien est membre actif de la commission locale de surveillance des gaz (CLSG). Des programmes d'entretien, de surveillance et des méthodologies de prélèvement/analyse sont définis et appliqués, avec traçabilité des travaux et gestion des incidents.
Coopération, sous-traitance, enseignement et recherche : l'évolution des PUI
Les PUI, au-delà de leurs missions internes, sont appelées à jouer un rôle croissant dans des dynamiques de coopération inter-établissements, de sous-traitance d'activités, et de participation active à l'enseignement et à la recherche. Ces évolutions sont clés pour l'optimisation des ressources et l'amélioration continue des soins.
La coopération entre PUI est un enjeu majeur, permettant de mutualiser les activités pharmaceutiques et d'optimiser la prise en charge des patients dans un objectif d'efficience et de sécurité optimale. Une PUI peut assurer des missions et activités pour le compte d'autres PUI, de professionnels de santé ou de laboratoires de biologie médicale, à condition d'être elle-même autorisée à exercer ces missions pour son propre compte. Si une PUI n'est plus en mesure d'exercer certaines de ses missions, elle peut en confier la mise en œuvre à d'autres PUI, l'ARS devant en être informée de cette organisation et de sa durée prévisionnelle.
La sous-traitance est également une modalité d'organisation essentielle pour les PUI. Une PUI peut sous-traiter diverses activités à des personnes morales respectant les bonnes pratiques, notamment:
- La délivrance de gaz à usage médical pour les patients en hospitalisation à domicile (HAD) ou hébergés par un établissement médico-social.
- Les opérations de contrôle relatives aux préparations magistrales, hospitalières et officinales, à un laboratoire sous-traitant agréé, avec un contrat écrit et information de l'ARS.
- La réalisation de préparations (hospitalières, magistrales, radiopharmaceutiques) et la reconstitution de spécialités pharmaceutiques à un établissement pharmaceutique autorisé, également via un contrat écrit soumis à l'avis de l'ARS.Le Référentiel insiste sur la définition claire des rôles de donneur d'ordre et de sous-traitant, l'établissement d'un cahier des charges, de plans d'audits, d'analyses financières, de systèmes d'information sécurisés et l'obtention des autorisations nécessaires.
L'enseignement et la formation constituent une mission importante des PUI. Elles dispensent des enseignements et des formations professionnelles et appliquées aux internes, étudiants, préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH) et stagiaires. Les PUI participent à l'élaboration et au suivi des objectifs de formation, organisent les activités hospitalières des apprenants et adaptent les méthodes pédagogiques aux objectifs définis.
La recherche scientifique est un axe de développement stratégique pour les PUI, notamment dans le cadre hospitalo-universitaire. Elles sont encouragées à structurer leurs activités de recherche autour de thématiques clairement identifiées, en lien avec des équipes scientifiques reconnues. La mise en place de méthodes de recherche validées est essentielle, avec des protocoles écrits, des plans expérimentaux définis et une évaluation a priori de la faisabilité des projets. Le respect des exigences éthiques et réglementaires est impératif, impliquant la déclaration des projets aux autorités compétentes (CPP, AFSSAPS), l'obtention des avis ou autorisations nécessaires, le consentement des patients et la conformité à la CNIL pour la gestion des bases de données. Enfin, les PUI soutiennent et organisent la valorisation de la recherche, par des communications, publications scientifiques, brevets et collaborations industrielles, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances et à l'amélioration des pratiques. La gestion des essais cliniques, spécifiquement, implique une organisation dédiée au sein de la PUI pour maîtriser le circuit des produits de santé expérimentaux (PSE) et garantir la confidentialité des données.
En définitive, la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) est bien plus qu'un simple service d'approvisionnement. Elle est un acteur multifacette et évolutif de la santé, au carrefour de la logistique, de la clinique, de la qualité, de la gestion des risques, de la coopération et de l'innovation. La refonte réglementaire récente a renforcé son rôle essentiel dans la sécurisation du parcours patient et la promotion du bon usage des produits de santé, tout en lui offrant des outils pour s'adapter aux dynamiques de collaboration et d'excellence. L'engagement de ses pharmaciens et de leurs équipes est fondamental pour garantir des soins de haute qualité et en constante amélioration.
Sources
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/contrats-et-financement/obligations-reglementaires/




