La fièvre au retour d'un voyage tropical : guide complet pour les voyageurs et les professionnels de santé
La fièvre est un symptôme universel, mais lorsqu'elle survient après un séjour dans une région tropicale, elle revêt une signification particulière et nécessite une attention immédiate. Bien qu'elle puisse signaler une maladie bénigne et auto-limitée, la fièvre au retour d'un voyage peut également être le premier signe d'une pathologie qui progresse rapidement et peut s'avérer létale. Il est donc crucial d'évaluer de manière urgente tout état fébrile chez un voyageur de retour. Les professionnels de santé doivent connaître les principales étiologies, les mesures préventives, et les démarches diagnostiques et thérapeutiques associées. De même, les voyageurs devraient être conscients des risques potentiels et des précautions à prendre avant, pendant et après leur séjour.
Comprendre la fièvre du voyageur : définitions et importance d'une évaluation rapide
La fièvre au retour d'un voyage tropical est le deuxième motif de consultation pour les voyageurs, représentant 23% des cas, juste après les troubles digestifs (42%) et avant les affections dermatologiques (17%). Cette statistique souligne l'importance de ce symptôme. Une évaluation rapide et adéquate est primordiale, car certaines pathologies peuvent évoluer très vite et menacer le pronostic vital. Il est important de noter que des pathologies tropicales peuvent être évoquées même chez des patients ayant voyagé plusieurs années auparavant, ou n'ayant pas voyagé du tout, comme dans le cas du "paludisme d'aéroport".
Les connaissances essentielles pour les professionnels de santé incluent la capacité à évaluer l'état général du patient, à procéder à un interrogatoire approfondi sur l'historique du voyage et à examiner les manifestations cutanées potentielles. Les recommandations de voyage sont régulièrement mises à jour et il est essentiel de consulter les directives des organisations internationales et des autorités sanitaires nationales pour les voyageurs et les professionnels de la santé. En France, le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique et l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) publient des recommandations spécifiques pour les voyageurs.
L'approche clinique d'un état fébrile au retour d'un voyage se décompose en quatre étapes fondamentales, permettant d'établir un diagnostic précis et d'assurer une prise en charge appropriée. Tout d'abord, il faut évoquer les infections cosmopolites, c'est-à-dire celles qui ne sont pas spécifiquement liées au voyage tropical, comme la grippe, les infections ORL, pulmonaires ou urinaires. Cependant, il est impératif de rechercher systématiquement le paludisme chez tout patient fébrile de retour des tropiques, quelle que soit la symptomatologie associée, car 10 à 30% des patients atteints de paludisme peuvent présenter de la toux, des nausées, des vomissements, des diarrhées ou des douleurs abdominales, mimant ainsi des infections plus banales.
La deuxième étape consiste à rechercher les pathologies aiguës et dangereuses qui nécessitent un traitement d'urgence. Celles-ci incluent le paludisme (malaria), la fièvre entérique (typhoïde, paratyphoïde), la rickettsiose, l'abcès amibien du foie, la méningite ou méningo-encéphalite, la trypanosomiase africaine (rare) et la fièvre virale hémorragique (rare). Ensuite, la troisième étape vise à diagnostiquer les pathologies qui, bien que rarement aiguës et dangereuses, requièrent un traitement spécifique. Parmi celles-ci, on compte la leptospirose, la borréliose, la brucellose, la schistosomiase (fièvre de Katayama), la leishmaniose et la maladie de Chagas. Enfin, la quatrième étape implique de considérer les pathologies qui ne nécessitent pas de traitement spécifique, telles que les viroses comme les hépatites virales, la dengue, le chikungunya et le Zika, ainsi que d'autres arboviroses.
Les pathologies à considérer : un spectre large d'infections
Le spectre des infections à considérer face à une fièvre au retour d'un voyage est vaste et varie selon la destination et les activités du voyageur. Les maladies cosmopolites sont les plus fréquentes, mais il est toujours essentiel d'exclure un paludisme.
Parmi les pathologies à connaître, on retrouve les infections digestives et les dermatoses qui sont également très fréquentes au retour de voyage. Concernant spécifiquement les diarrhées, elles peuvent être d'origine bactérienne (campylobacter, salmonella, shigella, E. coli entérotoxigène, E. coli entéro-invasif, Vibrio cholerae), parasitaires (giardia, cryptosporidium, cyclospora, entamoeba histolytica) ou virales. Quant aux lésions cutanées, les sources mentionnent les dermatophytoses, les lésions urticariennes (souvent liées à une piqûre d'insecte), les larves migrantes, les myiases, et l'exanthème de la dengue.
Les maladies tropicales peuvent se manifester par un état fébrile, souvent accompagné de symptômes moins spécifiques. Il est crucial de penser à la dengue, au chikungunya, aux autres arboviroses, au VIH, à la rickettsiose, à la brucellose, à la borréliose, à la leptospirose, à la leishmaniose viscérale, à la schistosomiase et aux autres helminthiases, ainsi qu'aux trypanosomiases.
L'épidémiologie est un facteur clé pour orienter le diagnostic. Par exemple, le Plasmodium falciparum est l'agent pathogène le plus fréquemment identifié lors de séjours en Afrique subsaharienne, représentant environ 30% des cas de fièvre au retour. En revanche, la dengue est l'étiologie principale en Asie du Sud-Est (13%) et en Amérique latine (8%). Les paludismes non-P. falciparum sont plus répartis (autour de 4-9% selon les régions). Les rickettsioses sont également présentes dans toutes ces zones (2-5%), et la fièvre entérique est plus fréquente en Asie du Sud-Est (3.4%). Une part significative des cas reste attribuée à d'autres causes ou est inconnue, soulignant la complexité du diagnostic différentiel.
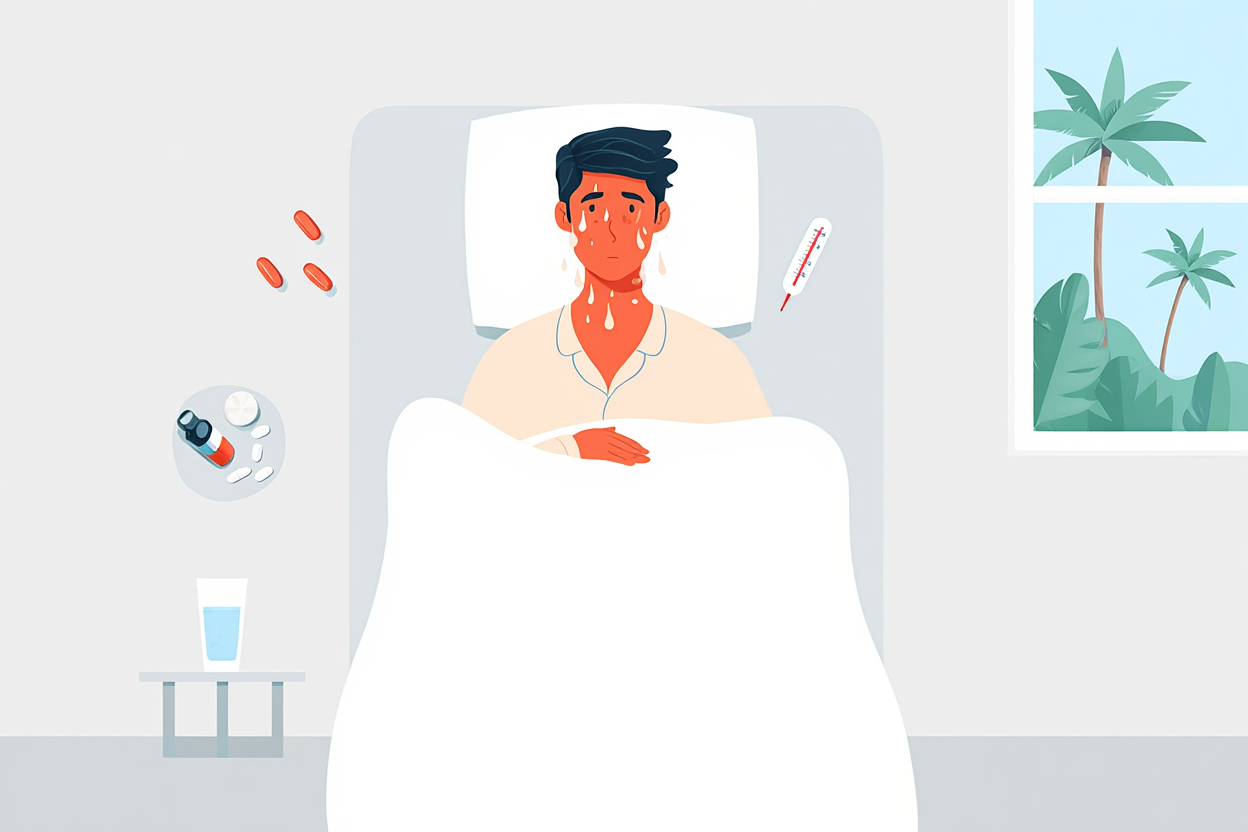
L'anamnèse et les manifestations cliniques : des indices essentiels au diagnostic
L'anamnèse est une étape fondamentale dans l'évaluation d'un patient fébrile de retour de voyage. Elle doit être minutieuse et comprendre des questions clés pour orienter le diagnostic étiologique. Ces questions incluent :
- Où le patient a-t-il voyagé ? Il est important de connaître les pays visités, et de savoir s'il s'agissait de villes ou de zones rurales, car certaines maladies sont endémiques dans des régions spécifiques.
- Quand le voyage a-t-il eu lieu ? La durée du séjour, la date de retour, et la saison du voyage sont des informations cruciales, notamment pour déterminer les temps d'incubation des maladies.
- Qui est le patient ? Les antécédents médicaux du voyageur peuvent influencer la susceptibilité à certaines infections.
- Comment s'est déroulé le voyage ? Cette partie de l'anamnèse est particulièrement riche en indices :
- Baignade ou rafting : Peut orienter vers la schistosomiase ou la leptospirose.
- Aliments consommés : L'ingestion de lait non pasteurisé peut suggérer une brucellose, tandis que la viande crue peut indiquer une trichinellose. Les aliments et l'eau contaminés sont un mode de transmission très courant et non spécifique de nombreux germes.
- Piqûres d'insectes : Les moustiques sont des vecteurs du paludisme, de la dengue, du chikungunya. Les tiques peuvent transmettre la Rickettsia africae ou la borréliose. Les puces sont associées à la Rickettsia typhi, et la mouche tsé-tsé à la trypanosomiase africaine. Il est à noter que de nombreux patients ne se souviennent pas d'avoir été piqués.
- Contacts sexuels à risque ou contact sanguin (dentiste, tatouage) : Peuvent suggérer une infection par le VIH ou l'hépatite B.
- Vaccinations reçues : Connaître le statut vaccinal (hépatite A, hépatite B, fièvre typhoïde, fièvre jaune) est important, sachant que 3% des états fébriles post-voyage sont évitables par la vaccination.
- Médicaments pris : La prise d'une prophylaxie antipalustre ou d'antibiotiques pendant le séjour peut modifier la présentation clinique ou le diagnostic de certaines maladies.
Les temps d'incubation sont des indices précieux. Par exemple, une dengue ne peut être responsable d'une fièvre débutant 20 jours après le retour, car son incubation est de 3 à 14 jours. De même, une fièvre débutant au lendemain d'un court séjour de 4 jours en Afrique de l'Ouest n'est pas un paludisme, l'incubation minimale étant de 7 jours. Le tableau des temps d'incubation mentionne des périodes pour la dysenterie bactérienne (<7 jours), la dengue (7-14 jours), le paludisme (7-21 jours), la leishmaniose viscérale (>4 semaines), entre autres.
Outre l'anamnèse, l'examen clinique complet est crucial. Certaines manifestations cliniques sont particulièrement contributives au diagnostic différentiel :
- Rash cutané : Peut être observé dans la rougeole, les arboviroses (dengue, Zika), les rickettsioses, la fièvre typhoïde ou la borréliose. L'exanthème de la dengue est un exemple notable.
- Tâche noire cutanée (escarre) : Caractéristique de certaines rickettsioses (R. africae, R. conorii).
- Conjonctivite : Associée à la leptospirose, aux rickettsioses, à la rougeole et à certaines arboviroses (Zika).
- Adénopathies : Peuvent indiquer une rubéole, une toxoplasmose, une infection à CMV ou VIH, des arboviroses, une tuberculose, une leishmaniose ou une trypanosomiase.
- Hépatomégalie : Suggère une hépatite, un abcès amibien, des douves (fasciolase), une leishmaniose ou un paludisme.
- Splénomégalie : Fréquente dans le paludisme, la leishmaniose et la fièvre entérique.
- Signes neurologiques : Impliquent des pathologies graves comme la méningite, l'encéphalite, la trypanosomiase ou le paludisme.
Les examens paracliniques : confirmer le diagnostic
Les examens paracliniques sont indispensables pour confirmer le diagnostic étiologique d'un état fébrile au retour de voyage. Un bilan de base doit être réalisé pour chaque patient, complété par des examens additionnels selon la suspicion clinique ou les résultats initiaux.
Le bilan de base comprend :
- Une formule sanguine complète (FSC), qui peut révéler une anémie ou une thrombopénie, fréquentes dans le paludisme.
- La protéine C réactive (CRP), la bilirubine, l'ASAT, l'ALAT (enzymes hépatiques) et la créatinine (fonction rénale). L'élévation des transaminases est fréquente dans la dengue, par exemple.
- Une recherche de paludisme systématique, incluant le frottis sanguin, la goutte épaisse et un test rapide (détection antigénique).
- Un sédiment urinaire.
Selon la suspicion clinique, des examens complémentaires peuvent être nécessaires :
- Un examen des selles (recherche de leucocytes, parasites, culture) en cas de troubles digestifs.
- Des hémocultures pour identifier des bactéries, notamment en cas de suspicion de fièvre entérique.
- Des sérologies virales et/ou bactériennes spécifiques pour des infections telles que les arboviroses (dengue, chikungunya), les rickettsioses, la leptospirose, l'amibiase, le VIH, la syphilis. Pour la dengue, le test rapide (détection de l'antigène NS1) est sensible dès les premiers jours de fièvre, et les IgM spécifiques apparaissent après 5 à 7 jours.
- Des sérologies parasitaires, notamment pour le dépistage des helminthiases après un séjour tropical.
- Des PCR (réaction en chaîne par polymérase) pour la détection directe d'agents pathogènes, par exemple pour le Zika ou l'Ebola.
- Une culture d'urines.
- Une ponction lombaire en cas d'atteinte neurologique (suspicion de méningite ou encéphalite).
- Une radiographie du thorax ou une échographie abdominale peuvent être indiquées. L'échographie abdominale est sensible pour l'abcès amibien du foie, bien que non spécifique.
Il est important de noter qu'en cas de fièvre avec éosinophilie, la cause la plus fréquente chez le voyageur est la schistosomiase aiguë. D'autres helminthiases doivent également être évoquées, telles que la trichinellose, la fasciolase (douves), la toxocarose, ainsi que l'anguillulose, l'ascaridiase et l'ankylostomiase en phase de migration.
La prise en charge du paludisme : une priorité absolue
Le paludisme, ou malaria, est une priorité absolue dans l'évaluation de toute fièvre au retour d'un voyage tropical. Il doit être systématiquement recherché, quelle que soit la symptomatologie associée, chez toute personne ayant séjourné en zone d'endémie. Le diagnostic peut être évoqué même plusieurs mois après le retour, et dans 2% des cas, il peut survenir plus d'un an après le voyage.
L'anamnèse précise est cruciale pour le paludisme :
- Pays visité : Trois quarts des cas diagnostiqués en Suisse sont contractés en Afrique, où le Plasmodium falciparum est responsable de 85% des cas. En Asie et Amérique latine, P. falciparum est en cause dans 17-22% des cas.
- Date de séjour : Le temps d'incubation minimal est d'une semaine. 95% des accès palustres surviennent dans les deux mois suivant le retour.
- Prophylaxie antipalustre : Il est important de savoir si une prophylaxie adéquate a été prise ou non, ou si un traitement antibiotique (cotrimoxazole, tétracyclines, macrolides, fluoroquinolones) ayant une activité anti-palustre partielle était en cours.
Les manifestations cliniques du paludisme sont souvent peu spécifiques, mimant un état grippal avec fièvre, céphalées, frissons, sudations profuses et myalgies. Plusieurs facteurs rendent le diagnostic plus probable : une prophylaxie anti-malarique inadéquate ou absente, une splénomégalie, une anémie (<12 g/dl) et une thrombopénie (<150 G/l). Il est à noter que 40% des patients atteints de paludisme sont afébriles lors de la première consultation, ce qui renforce l'importance de la recherche systématique.
Le diagnostic repose sur la réalisation d'un frottis sanguin, d'une goutte épaisse et, éventuellement, d'un test rapide. Des analyses sanguines complémentaires sont indiquées : FSC, glycémie, sodium, bilirubine, ALAT, créatinine, lactates et TP, ainsi qu'un sédiment urinaire. Il est essentiel de savoir que les cas de paludisme dus à P. vivax, P. ovale, P. knowlesi et P. malariae peuvent également présenter des manifestations cliniques parfois sévères et nécessitent une prise en charge et un traitement sans délai.
La prise en charge dépend des résultats de la recherche de paludisme :
- Si le résultat est négatif, mais qu'il y a une forte suspicion, il est recommandé de répéter deux recherches supplémentaires à moins de 24 heures d'intervalle, surtout si le séjour a eu lieu dans une zone à forte transmission.
- Si le résultat est positif et qu'il n'y a aucun signe de gravité ou autre critère d'hospitalisation, un traitement ambulatoire peut être envisagé, avec un contrôle clinique et de la parasitémie à 24 heures. Il est crucial de surveiller l'évolution, car l'état clinique peut s'aggraver rapidement en 2-3 jours chez l'adulte et en moins de 24 heures chez l'enfant.
Les critères de gravité du paludisme nécessitent une hospitalisation immédiate et un traitement intraveineux :
- Manifestations cliniques : Prostration, troubles de la conscience, détresse respiratoire (respiration acidosique), convulsions multiples, collapsus cardiovasculaire (TAs <70 mmHg), œdème pulmonaire radiologique, saignement anormal, ictère (bilirubine totale >50 μmol/l), hémoglobinurie.
- Manifestations biologiques : Anémie sévère (Hb <8 g/dl), hypoglycémie (<2.2 mmol/l), acidose métabolique (bicarbonate plasmatique <15 mmol/l), insuffisance rénale aiguë (sans amélioration après réhydratation) avec diurèse <400 ml/24h et créatinine >265 μmol/l, hyperlactatémie (>5 mmol/l), hyperparasitémie (>5%). Une parasitémie peut être faussement basse en cas de traitement antipaludéen récent insuffisant ou de prise d'antibiotiques ayant une activité antipalustre.
Les critères d'hospitalisation incluent la présence d'au moins un critère de gravité (tableau 6) ou la présence d'éléments tels que des vomissements, une parasitémie >2% chez une personne non-immune, une altération marquée de l'état général, la grossesse, une immunosuppression, une asplénie, un âge supérieur à 60 ans ou le fait d'être seul à domicile.
Le traitement du paludisme non compliqué de premier choix est l'Artéméther + luméfantrine (Riamet®), administré en 4 comprimés deux fois par jour pendant 3 jours. Ce traitement est contre-indiqué en cas de QT long (congénital, troubles électrolytiques, médicamenteux). Les alternatives incluent l'Atovaquone + proguanil (Malarone® ou Atovaquone Plus Spirig HC®) à raison de 4 comprimés par jour pendant 3 jours. La Chloroquine (base) peut être utilisée pour le paludisme à P. vivax, P. ovale ou P. malariae, sauf si P. vivax est résistant. Il est recommandé de garder le patient en observation au moins une heure après la première dose en raison du risque de vomissements, et de prendre l'Artéméther + luméfantrine ou l'Atovaquone + proguanil avec un repas ou un verre de lait pour améliorer l'absorption. En cas de grossesse, l'hospitalisation est préférable. Si des signes de gravité ou des vomissements incontrôlables apparaissent, une hospitalisation d'urgence est indiquée pour un traitement intraveineux par Artésunate. Pour les infections à P. vivax ou P. ovale, l'adjonction de primaquine peut être discutée pour prévenir les rechutes, en tenant compte des contre-indications (déficit en G6PDH, grossesse).

Autres pathologies fréquentes et leur gestion : fièvre entérique, abcès amibien et dengue
Au-delà du paludisme, d'autres pathologies tropicales sont fréquemment rencontrées et nécessitent une prise en charge spécifique. Parmi elles, la fièvre entérique, l'abcès amibien hépatique et la dengue sont particulièrement notables.
La fièvre entérique (typhoïde ou paratyphoïde)
Le risque de fièvre entérique est présent pour les voyageurs dans tous les pays en développement, mais il est particulièrement élevé en Asie du Sud (par exemple, Inde, Népal). La vaccination (Vivotif® ou TyphimVi®) offre une efficacité de 60 à 70%. Les manifestations cliniques typiques incluent une fièvre, une dissociation pouls-température, de la constipation ou de la diarrhée, une toux sèche et des douleurs abdominales.
Le diagnostic cardinal de la fièvre entérique est l'hémoculture, dont la sensibilité est d'environ 80% pendant la première semaine de fièvre, mais diminue par la suite. La culture de selles est positive dans un tiers à deux tiers des cas entre la deuxième et la quatrième semaine. La FSC peut montrer des leucocytes normaux ou abaissés, et la CRP est élevée. Il est important de noter que la sérologie est jugée inutile pour le diagnostic.
La prise en charge varie selon l'état général du patient :
- Si l'état général est marqué ou en cas de complication, la Ceftriaxone à 2 g/j en intraveineuse est administrée pendant 10 à 14 jours.
- Si l'état général est conservé, la Ciprofloxacine 500 mg deux fois par jour pendant 14 jours est une option. L'Azithromycine, avec une dose de charge de 1g suivie de 500 mg une fois par jour pendant 6 jours, est privilégiée pour la fièvre typhoïde ou paratyphoïde acquise en Asie du Sud, en raison des résistances aux fluoroquinolones.
L'abcès amibien hépatique
L'abcès amibien hépatique se manifeste le plus souvent sans atteinte colique associée et présente une nette prédominance masculine. Les manifestations cliniques principales sont une douleur de l'hypochondre droit et une hépatomégalie. Un syndrome pleuro-pulmonaire d'accompagnement de la base droite est présent dans 30% des cas.
Le diagnostic est principalement confirmé par une sérologie positive dans plus de 85% des cas. L'échographie abdominale, et éventuellement le scanner, sont des examens sensibles mais non spécifiques, révélant la présence de l'abcès.
La prise en charge implique un traitement par Métronidazole, administré à 750 mg par voie intraveineuse ou per os, trois fois par jour pendant 10 jours, suivi de Paromomycine à 3x500mg/j pendant 5 jours.
La fièvre dengue
La fièvre dengue est une maladie virale causée par quatre sérotypes distincts, transmise par des moustiques dans les pays tropicaux et subtropicaux. Elle est de plus en plus fréquemment diagnostiquée chez les voyageurs fébriles. Les manifestations cliniques classiques de la dengue sont celles d'un état grippal intense, avec une forte fièvre durant 1 à 6 jours, des céphalées, des myalgies, des arthralgies et un rash cutané (présent chez 50% des patients, souvent après l'épisode fébrile).
Les complications, principalement hémorragiques, sont très rares chez le voyageur. Elles se manifestent généralement au dernier jour de la fièvre ou le lendemain, et incluent des maux de ventre intenses, une hypotension et des manifestations hémorragiques. Les sujets ayant déjà eu un épisode de dengue sont les plus à risque de développer des formes compliquées.
Le diagnostic de la dengue repose sur la sérologie (IgM spécifiques détectables dès le 5ème-7ème jour après le début de la fièvre) et un test rapide de détection de l'antigène circulant NS1, qui confirme la dengue dès les premiers jours avec une sensibilité d'environ 80%. Biologiquement, une thrombopénie et une leucopénie sont maximales au 3ème-4ème jour du début de la fièvre, et une élévation des transaminases, parfois avec une hépatite franche, est observée.
Il n'existe ni traitement spécifique ni vaccin pour la dengue. La prise en charge vise principalement à assurer une hydratation suffisante. Le paracétamol peut être prescrit pour la fièvre et les douleurs, mais les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) et surtout l'aspirine doivent être évités en raison du risque hémorragique.
Les fièvres virales hémorragiques : une urgence rare mais grave
Les fièvres virales hémorragiques, incluant l'Ebola, le Marburg, le Congo-Crimée et le Lassa, sont des diagnostics extrêmement rares au retour de voyage. Cependant, leur potentiel de transmission de personne à personne représente un risque sanitaire majeur, nécessitant la mise en place rapide de mesures spécifiques en cas de suspicion.
Une fièvre virale hémorragique doit être évoquée dans des situations bien définies :
- Présence d'une fièvre associée à des hémorragies (épistaxis, rectorragies, hématomes).
- Anamnèse de contact avec un cas suspect ou confirmé de fièvre virale hémorragique.
- Retour d'une zone épidémique ou hautement endémique pour ces virus.
Le diagnostic en cas de suspicion clinique nécessite l'analyse rigoureuse d'échantillons (examens sanguins de routine, analyses sérologiques et biologie moléculaire).
La prise en charge d'une suspicion de fièvre virale hémorragique est une urgence absolue :
- Hospitalisation immédiate du patient.
- Mise en place de mesures d'isolement strictes.
- Traitement spécifique selon l'avis des consultants spécialisés en médecine tropicale et en maladies infectieuses.
Ces mesures visent à protéger le patient, le personnel soignant et la communauté face à un risque de propagation élevé, même si le nombre de cas importés reste très faible.
Prévention : voyager en toute sécurité
La prévention des maladies liées aux voyages est une composante essentielle de la médecine des voyages, permettant de réduire considérablement les risques de contracter des infections, y compris celles qui peuvent entraîner une fièvre au retour. Avant tout voyage, il est fortement recommandé de consulter un professionnel de santé spécialisé dans la médecine des voyages. Cette consultation permet d'évaluer les risques spécifiques liés à la destination, au type de voyage et au profil du voyageur, et de délivrer des conseils personnalisés.
Les mesures préventives générales sont fondamentales et doivent être scrupuleusement suivies :
- Hygiène des mains : Le lavage fréquent des mains est crucial, en particulier avant les repas et après être allé aux toilettes. L'utilisation de solutions hydroalcooliques est une alternative efficace en l'absence d'eau et de savon.
- Sécurité alimentaire et hydrique : Il est impératif de boire de l'eau en bouteille capsulée ou rendue potable (bouillie, filtrée ou désinfectée). Les aliments crus, les glaçons, les légumes non lavés, les produits laitiers non pasteurisés et la viande crue sont à éviter. "Cuit, bouilli, pelé ou oublié" est la règle d'or.
- Protection contre les piqûres d'insectes : Utilisation de répulsifs cutanés efficaces, de moustiquaires imprégnées d'insecticide pour dormir, de vêtements couvrants et de climatisation si disponible. Ces mesures sont vitales dans les zones à risque de paludisme, dengue, chikungunya, Zika et autres arboviroses.
- Sécurité sexuelle : Éviter les contacts sexuels à risque et utiliser des préservatifs pour prévenir les infections sexuellement transmissibles.
- Protection sanguine : Éviter les contacts avec le sang et les aiguilles non stériles.
Les vaccinations jouent un rôle majeur dans la prévention et sont adaptées en fonction de la destination et des risques spécifiques :
- Hépatite A et B : Recommandées pour de nombreuses destinations, en particulier dans les pays où l'hygiène est précaire.
- Fièvre typhoïde : Recommandée pour les séjours en Asie, en Afrique et en Amérique latine, surtout en zone rurale ou lors de séjours prolongés. L'efficacité est de 60-70%.
- Fièvre jaune : Obligatoire pour certaines destinations et fortement recommandée pour d'autres en zone endémique (Afrique et Amérique du Sud).
- Méningite à méningocoque : Recommandée pour les pèlerins se rendant à La Mecque et pour les séjours prolongés en Afrique subsaharienne.
- Rage : Recommandée pour les voyageurs exposés aux animaux, en particulier en Asie et en Afrique.
- Encéphalite japonaise : Recommandée pour les séjours ruraux prolongés en Asie.
- Encéphalite à tiques : Recommandée pour les zones forestières d'Europe centrale et orientale.
- COVID-19 : La vaccination est recommandée et doit être à jour pour tout voyage international.
Au-delà des maladies vectorielles et hydriques, d'autres risques divers existent et nécessitent une vigilance :
- Parasitoses : Certaines parasitoses, comme la schistosomiase, sont contractées par contact avec l'eau douce contaminée. Il est essentiel d'éviter la baignade en eau douce stagnante.
- Contacts avec des animaux : Morsures, griffures ou simples contacts peuvent transmettre des maladies (rage, brucellose). Il est conseillé de ne pas approcher ni nourrir les animaux.
- Accidents et noyades : Première cause de mortalité et de morbidité chez les voyageurs. La prudence est de mise, notamment lors des activités sportives.
- Envenimations et contacts végétaux : Certaines zones présentent des risques de morsures de serpents, scorpions ou d'insectes venimeux, ainsi que des réactions cutanées au contact de certaines plantes.
En résumé, bien que les maladies cosmopolites soient les plus fréquentes, il est impératif d'écarter toujours le paludisme en cas de fièvre au retour d'un voyage tropical. En présence d'une première recherche de paludisme négative après un séjour dans une zone de forte transmission, deux recherches supplémentaires à moins de 24 heures d'intervalle sont nécessaires. Si le patient présente une altération marquée de l'état général et que le paludisme est exclu, il convient de discuter un traitement présomptif contre la fièvre entérique et éventuellement les rickettsioses. Une préparation minutieuse avant le départ et une vigilance accrue pendant et après le voyage sont les clés d'un séjour sûr et d'un retour en bonne santé.
Source
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-09/strategie_fievre_voyage.pdf




